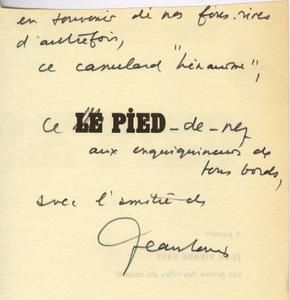Françoise Donaire est une amie psychologue qui vient de publier chez manuscrit.com ce roman passionnant et superbement écrit. N'hésitez pas à laisser vos commentaires... Je transmettrai
MINO le fantôme
C'était troublant, rien ne bougeait. Les façades s'alignaient, toutes inhabitées, d'un gris-beige si homogène qu'on aurait juré un décor. Les vitres luisaient à peine, juste assez pour se refléter l'une dans l'autre et s'assombrir mutuellement. Il n'y avait pas un chat, pas un papier par terre, pas un cheveu dans le caniveau, pas un effluve radiophonique, pas une voiture garée, pas un cri d'oiseau, pas l'ombre d'une fourmi œuvrant sur les trottoirs. C'était vide.
Sous influence, je m'arrêtai devant le numéro 16. La porte bien sûr était fermée, une porte lourde et verte, assez bien entretenue, ma foi. Il y avait à main droite un petit clavier pour taper le code d'ouverture, j'appuyai gaillardement sur le bouton du bas. La porte ne s'ouvrit pas.
Bêtement, je regardai au loin, d'un côté puis de l'autre, comme si le vide sidéral qui régnait dans la rue pouvait m'inspirer. Il ne m'inspira pas. L'examen du petit clavier n'apporta rien non plus. Il me fallait le code et je ne l'avais pas. Derrière mes yeux, le visage du fantôme se mit à clignoter, manière de dire que le moment était fâcheux et que la situation se présentait mal. Il ne pouvait m'être d'aucune aide, le pauvre, n'ayant pas la moindre expérience des codes-portes.
J'avisai que la fenêtre de droite, rayée de l'intérieur par un store vénitien, laissait filtrer une vague lumière électrique. Je me haussai et frappai au carreau. Je dus frapper longtemps.
- Oui ? dit un monsieur qui paraissait déjà fatigué.
- Je, j'ai oublié le code.
Il ouvrit un peu plus le battant. A part la fatigue, son visage n'exprimait absolument rien. Il pouvait avoir dans les cinquante ans. Ou moins.
- Le code, répéta-t-il.
- Oui, le code d'entrée. Je, je n'arrive pas à me le mettre dans la tête.
- Il n'est pas compliqué pourtant. Pas du tout compliqué.
- Oui, euh, ça, je m'en souviens. Mais des chiffres, non.
- Il y a une lettre aussi.
- Oui, je sais.
Il n'était même pas soupçonneux. Il n'essayait pas de jouer au chat et à la souris. Il ne s'amusait pas non plus, on ne pouvait pas dire ça.
- Essayez de vous souvenir, conseilla-t-il.
Mais il ne referma pas la fenêtre. Il me regardait essayer, juste pour voir, comme ça.
- La lettre est en deuxième, je lançai.
- Oui. C'est bien ! Continuez.
Il s'accouda carrément, attentif comme devant sa télé.
- C'est un B. Ou un A.
- Un B ou un A ?
Je scrutai le ciel.
- Un A.
- Non. Essayez encore.
- Un B, affirmai-je triomphalement.
- Non.
Je l'examinai soigneusement (il était à cinquante centimètres), je lui trouvai le teint brouillé, la bouche sinueuse, le rasage approximatif. J'en déduisis qu'il était un humain normal, mais ses intentions me semblaient absconses.
- Ecoutez, Monsieur, je vais vous dire : je suis la petite amie de votre voisin du cinquième et je
- Lequel ?
- Monsieur Pradesgurvic, je ne sais pas si vous le connaissez.
- Goran ? Le Serbe ?
- Oui !
Dans mon for intérieur, dont les remparts avaient sombrement vacillé, je remerciai la Serbie.
Mon sphinx eut une remarque étourdie.
- Je croyais qu'il n'aimait que les blondes.
Je pris un masque outragé. Il fallait profiter de la moindre faille.
- Vous pourriez m'épargner ce genre de réflexions, c'est vraiment d'un goût !
(Généralement ça marche bien.)
- Désolé. Tout à fait désolé, je n'ai pas l'habitude. Euh, ce genre de situation vous comprenez. Le code c'est 1C et trois fois 7.
- Ah oui c'est ça ! je m'écriai.
Une fois la grande porte repoussée derrière moi, je suis restée un peu dans l'obscurité. Je reniflais l'odeur. On sait que chaque maison a son odeur. Evidemment elle est faite de toutes celles des vivants qu'elle abrite mais au-delà de ces écorces d'odeurs qui se recouvrent et s'emberlificotent, il reste un noyau, un centre, qui lui reste inchangé. Le 16 rue de Bellefond avait son odeur, et c'était la même depuis 1919. Endormi ou trop faible encore, mon fantôme ne broncha pas. Mon nerf olfactif, excité comme il convient, fit son travail d'enregistrement. Ensuite j'entrepris de monter l'escalier.
Pour découvrir une critique parue sur ce roman sur le site de manuscrit.com, cliquez dans la colonne de gauche sur la rubrique "critiques"